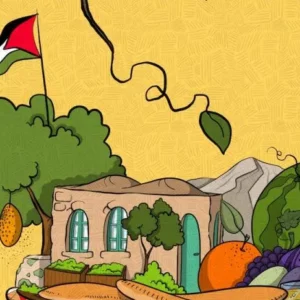Pourquoi nous boycotterons la saisine du CESE par François Bayrou sur « Qu’est-ce qu’être Français ? »
Ou pourquoi il est impossible de discuter de « l’identité nationale » sans glisser vers l’idéologie d’extrême droite et participer à la légitimation de ses idées.
Ce matin, François Bayrou, Premier ministre, a officiellement confié au CESE (Conseil économique, social et environnemental) ainsi qu’aux CESER (Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux) la mission d’organiser un vaste débat national autour de la question : « Qu’est-ce qu’être Français ? ». Autrement dit, il s’agit d’un débat sur l’« identité nationale » imposé par le Premier Ministre sous couvert de consultation.
Pour les Amis de la Terre France, qui siègent au CESE, cette initiative, présentée comme une démarche de réflexion collective, s’inscrit en réalité dans une longue tradition de mises en scène politiques qui prétendent « consulter » la société, tout en cadrant dès le départ la discussion dans des termes profondément biaisés. Derrière l’apparente ouverture, il s’agit surtout d’imposer un récit national fondé sur l’exclusion, de faire porter à la société civile un débat toxique, et de déplacer la conflictualité sociale vers un terrain identitaire. Il est donc urgent de déconstruire la nature même de cette démarche et d’en dénoncer les implications.
Discuter de l’identité nationale, et en particulier répondre à la question « qu’est-ce qu’être Français·e ? », est une entreprise aussi vaine que dangereuse. Cette question, en apparence anodine, cache en réalité une logique d’exclusion. Elle présuppose qu’il existerait une définition unique, figée, presque « pure » de la nationalité, ce qui est non seulement historiquement faux, mais également porteur d’un imaginaire profondément raciste.
La France, comme toute construction politique, est une construction historique, politique et mouvante. Ce sont des siècles de métissage, de migrations, de révolutions culturelles, linguistiques et sociales. Chercher à définir « l’identité française » reviendrait donc à figer quelque chose qui, par nature, est en constante transformation. Pourtant, lorsque certain·e·s s’acharnent à poser cette question, à l’imposer dans le débat public, ce n’est pas pour en chercher la richesse, mais pour en délimiter les frontières. Qui est Français·e ? Mais surtout, qui ne l’est pas ? Qui ne l’est pas « vraiment » ?
C’est là que le cadrage de ce débat devient dangereux.
La question de l’identité nationale a toujours été mobilisée par l’extrême-droite pour construire un « eux » contre un « nous ». Elle s’appuie sur une vision ethnocentrique, excluant les Français·es issu·es de l’immigration, les Français·es musulman·es, ou encore les Français·es noir·e·s ou asiatiques, comme s’ils portaient en elles et en eux une altérité incompatible avec « la vraie France ». Poser la question et a fortiori, accepter d’y répondre, c’est légitimer cette vision hiérarchisée de la citoyenneté.
En cela, cette interrogation est fondamentalement raciste. Non pas forcément dans l’intention de celles et ceux qui la formulent, mais dans les implications qu’elle porte. Elle naturalise l’appartenance nationale, comme si être Français·e était une essence, une couleur de peau, un prénom, une religion. Elle ne questionne pas une appartenance politique ou civique, mais culturelle, identitaire, avec une norme implicite : le·la Français·e blanc·he, catholique (ou laïque mais jamais musulman·e), parlant sans accent, et qui s’appelle Pierre, Paul ou Marie.
Ce faux débat attaque directement les fondements même de la vie commune. Il vide de leur sens les trois piliers de sa devise : Liberté, Égalité, Fraternité. Car que reste-t-il de la liberté lorsqu’on exige des citoyen·ne·s qu’iels se conforment à un modèle culturel unique ? Que devient l’égalité lorsque certain·e·s doivent sans cesse justifier leur présence, leur loyauté, leur droit à être ici ? Et qu’en est-il de la fraternité, si elle ne s’applique qu’à celle et ceux qui nous ressemblent ?
Lorsque les responsables politiques ou les médias mettent cette question au centre du débat public, ils et elles créent un terrain favorable aux thèses et aux cadres idéologiques de l’extrême droite : non seulement iels légitiment l’idée qu’il faudrait filtrer, trier, distinguer les « bon·ne·s » Français·e·s des autres, leur donner des droits différents en fonction de leur statut, mais iels offrent aussi une plateforme aux discours de rejet. Cela renforce les sentiments d’exclusion chez une partie de la population française, qui se voit constamment sommée de prouver sa « francité ».
Ce faux débat détourne l’attention des vrais enjeux : inégalités sociales et de genre, racisme systémique, crise écologique, précarisation du travail, violences sexistes… Il essentialise des tensions sociales comme étant des problèmes culturels. Il transforme les victimes de discriminations en coupables du supposé déclin de l’identité nationale. Ce déplacement est non seulement mensonger, mais il prépare idéologiquement les esprits à accepter l’autoritarisme identitaire de l’extrême droite.
Et surtout, il empêche de poser la seule vraie question politique qui vaille : qu’est-ce qu’être citoyen·ne ? Être citoyen·ne, c’est appartenir à une communauté politique, c’est participer à la vie démocratique, c’est avoir des droits, des devoirs, une voix. Ce n’est ni un prénom, ni une religion, ni une origine. L’idée même d’« identité nationale » est un piège : elle détourne, elle divise, elle détruit.
La citoyenneté repose sur le vivre-ensemble, sur le contrat social, pas sur une prétendue essence nationale. C’est à cette définition qu’il faut revenir si l’on veut la défendre face aux tentatives de repli identitaire. La question de l’identité française n’est pas seulement mauvaise : elle est une impasse qui nous éloigne de l’idéal démocratique, qui devient de plus en plus fragile.
Dans ce contexte, il est non seulement légitime, mais nécessaire, que le CESE refuse de se prêter à cette mise en scène politique imposée par le Premier ministre. Notre Assemblée est l’un des derniers remparts constitutionnels de la démocratie délibérative, un espace où la société civile peut encore faire entendre une parole libre, diverse et représentative. L’entraîner dans une opération idéologique qui légitime les cadres de pensée de l’extrême droite reviendrait à en pervertir le rôle.
Le CESE, en tant qu’instance représentative de la diversité des composantes de la société française, ne peut cautionner une démarche qui, sous couvert de consultation, cherche à légitimer une idéologie identitaire, et participe de la normalisation du discours d’extrême droite. En acceptant ce cadrage imposé par le Premier ministre, le CESE trahirait non seulement sa mission, mais aussi les principes républicains qu’il est censé défendre. Son boycott est donc un acte de résistance démocratique, une manière de rappeler que la République ne se construit pas sur l’exclusion, mais sur l’égalité des droits et la reconnaissance de toutes les citoyennetés.
Dans un moment où les populismes autoritaires gagnent du terrain, où l’on voit Donald Trump mettre à mal l’ensemble des piliers de la démocratie américaine, où des milliardaires comme Elon Musk concentrent un pouvoir d’influence démesuré sur l’espace public, affaiblir les contre-pouvoirs, même symboliquement, est une faute grave. Les institutions comme le CESE doivent tenir, refuser d’être instrumentalisées, préserver la démocratie contre sa propre tentation de basculement.
Le boycott d’un tel débat n’est pas un refus de débattre, mais un acte profondément politique. C’est dire qu’on ne débat pas de la dignité, de l’égalité ou de l’appartenance. On les garantit. Collectivement. Fermement.